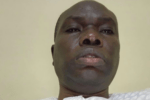Chapeau :
Alors que le nouveau pouvoir issu de la révolution citoyenne portée par PASTEF prend ses marques, Mahamadou Sagna, sociologue, appelle à ne pas céder à la tentation du compromis. Il plaide pour une ligne claire : audit de la dette, justice pour les blessés et victimes, reddition des comptes de l’ancien président Macky Sall, et rupture lucide avec la logique d’alignement imposée par le FMI.
L’accession de PASTEF à la magistrature suprême du Sénégal ne relève pas d’un simple changement de gouvernement. Elle consacre l’aboutissement d’une mobilisation citoyenne de grande ampleur, portée par une jeunesse debout, une société civile engagée et une diaspora vigilante. Cette victoire est l’expression d’un mandat clair : tourner la page d’un système jugé inégal, prédateur et opaque, et reconstruire l’État sur des bases de justice, de souveraineté et de dignité.
Mais une fois la victoire acquise, vient l’épreuve du pouvoir. Déjà, certains signes de prudence, voire d’hésitation, font craindre un glissement progressif vers une gestion classique, au détriment de la rupture annoncée. Or, les attentes sont profondes. Et les cicatrices, encore vives.
Rompre avec le système, pas l’apprivoiser
Changer un système, ce n’est pas seulement renouveler les visages. C’est s’attaquer aux structures profondes : la manière dont l’économie est pensée, dont la dette est contractée, dont les règles sont dictées et les priorités imposées. À ce titre, le Fonds Monétaire International (FMI) ne peut être abordé comme un partenaire neutre. Il est une institution structurante du système contre lequel PASTEF s’est construit.
Depuis des décennies, le FMI agit en Afrique comme un gardien de l’orthodoxie budgétaire, imposant des réformes d’austérité en échange d’appuis financiers souvent dérisoires. Sous couvert de stabilité macroéconomique, ses plans ont conduit à des coupes dans les services publics, à la précarisation des économies rurales, et à l’affaiblissement de l’État social.
Au Sénégal, cette présence s’est traduite par une caution systématique aux politiques d’endettement de l’ancien régime, sans exigence de transparence ni de résultats tangibles. Le FMI a ainsi légitimé un cycle de dettes toxiques, contractées pour financer des projets de prestige sans impact réel sur les inégalités.
Aujourd’hui, continuer à se plier aux recommandations du FMI reviendrait à neutraliser toute ambition de rupture. Car la logique de cette institution reste fondée sur l’ajustement, la compression des dépenses, la flexibilité du travail, et la libéralisation des marchés — des mesures historiquement incompatibles avec une politique de justice sociale ambitieuse.
Des précédents qui défient l’ordre établi
L’histoire récente offre pourtant des alternatives. En 2008, Rafael Correa, alors président de l’Équateur, fit réaliser un audit complet de la dette publique. Le rapport conclut à l’illégitimité d’une partie substantielle de cette dette. Correa suspendit le paiement des titres concernés, affrontant les marchés avec sang-froid. Résultat : l’Équateur réussit à racheter ses obligations à prix cassé et à réaffecter les fonds économisés aux secteurs sociaux.
En Bolivie, Evo Morales fit un choix radical : reprendre le contrôle des ressources naturelles. En renationalisant les hydrocarbures, son gouvernement put financer une politique sociale inédite, tout en se libérant progressivement des conditionnalités des institutions de Bretton Woods.
Même Jerry Rawlings, au Ghana, dans un tout autre contexte, avait compris la nécessité de restaurer une souveraineté économique minimale pour fonder une discipline budgétaire appuyée sur des critères nationaux, et non sur les agendas extérieurs.
Ces expériences montrent que l’affrontement avec le FMI n’est ni suicidaire, ni isolé, s’il est bien préparé, adossé à une base populaire et accompagné d’alliances internationales alternatives. Ce qui est suicidaire, c’est la résignation.
Une révolution a un prix : reconnaître les blessés
La révolution qui a porté PASTEF au pouvoir n’a pas été une abstraction théorique. Elle a coûté cher. Des Sénégalais ont été tués, blessés, mutilés. Des jeunes vivent aujourd’hui avec des balles dans le corps, des yeux perdus, des poumons abîmés. Des familles ont été détruites.
Ces blessés et ces martyrs doivent être considérés comme les fondations vivantes de la République nouvelle. Ils méritent :
une prise en charge médicale intégrale et durable,
une indemnisation à la hauteur de leur sacrifice,
une reconnaissance officielle, nationale et institutionnelle.
Les oublier, ce serait trahir. Pire : ce serait confirmer que la révolution fut un simple tremplin électoral, non un projet de transformation.
Macky Sall doit répondre
La refondation ne peut être complète sans clarification du passé récent. L’ancien président Macky Sall doit répondre de ses actes : endettement massif, répression politique, détournement de l’appareil judiciaire, privatisation des ressources. Il ne s’agit pas de vengeance, mais de rétablir le principe de reddition des comptes au sommet de l’État.
Un procès équitable, transparent et rigoureusement encadré doit être engagé, pour que l’impunité ne soit plus la règle tacite des régimes déchus.
L’heure des décisions
PASTEF ne peut gouverner comme un parti arrivé au pouvoir par la routine. Il doit gouverner comme un mouvement né d’une révolution, porteur d’un mandat historique. Cela implique des décisions nettes :
auditer la dette ;
rompre avec la logique d’alignement automatique au FMI ;
protéger les blessés, reconnaître les martyrs ;
établir la vérité sur les crimes économiques et politiques passés.
Le peuple sénégalais a montré sa capacité à vaincre la peur. Le pouvoir doit aujourd’hui montrer sa capacité à tenir sa promesse.
Lamine Sagna