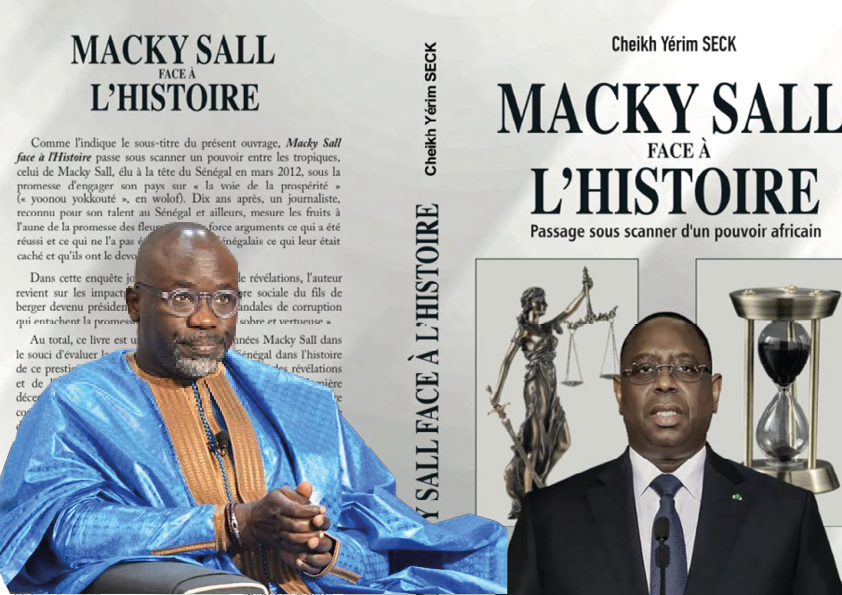« Premier mai! L’amour gai, triste, jaloux, brûlant… », chantait ainsi Victor Hugo.
Voltaire, philosophe des lumières remarque avec pertinence: » Le travail nous éloigne de trois choses: l’ennui, le vice et le besoin ». Le premier mai ainsi consacré officiellement, depuis le XIXe siècle, suite à d’âpres luttes syndicales, la journée internationale du travail, généralement ornée de festivités, d’ambiances et de traditions populaires rend la journée gaie et agréable pour rendre un hommage mérité au monde ouvrier, aux forces motrices du développement économique et social; bref aux travailleurs. Ce qui en fait un jour férié, chômé et payé, a-t-on dit.
Mais, ayons la force et le courage de percer le décor pour voir l’envers.
En vérité, le travail devrait être, tout compte fait, un culte pour le triomphe de notre humanité avant même d’être »le fondement de l’économie » comme le soutient Karl Marx, en ce sens qu’il permet à l’homme d’être au service de sa communauté, de contribuer activement à la transformation de la nature pour le bien-être commun, pour ainsi dire, son propre mieux-être.
En revanche, avec la montée en puissance du capitalisme bancaire et industriel dont le triomphe impose au monde du travail une forme écrasante de servitude monétaire, les travailleurs d’aujourd’hui dans leur plus grande majorité, croupissent dans les geôles de la misère et du désespoir.
Alors, dans son roman » Le talon de fer », publié en 1908, l’écrivain américain Jack London dresse un réquisitoire on ne peut plus sévère contre un système capitaliste en complicité avec l’aristocratie boursière dans un monde contemporain où les travailleurs se font écraser par la boulimie du pouvoir du patronat au point que ces derniers n’auront le choix qu’entre une mort lente et patiente à cause d’une invincible misère, et une servitude volontaire.
De ce capitalisme néolibéral découlent la violence structurale du chômage, la précarité du monde du travail ainsi même que la menace de licenciement stratégique ou abusif au profit d’une »armée de réserve de chômeurs » pour reprendre Bourdieu. Et le déploiement du mouvement syndical apparaît comme l’expression d’une volonté de la masse des travailleurs de mettre fin à cette forme d’esclavage moderne qui ne fait que répandre la pauvreté, la misère, la dépendance et l’angoisse existentielle; devant lequel mouvement se dresse, alors, un patronat cynique et sans pitié. Ainsi, le droit du travail devient un champ de bataille à la fois juridique et administrative où s’affrontent sans pitié, ni compassion, encore moins compromission, des employeurs prompts à réprimer toute velléité de revendication professionnelle et des employés animés par une volonté inouïe de discipliner le pouvoir patronal.
Malheureusement, dessoudés du mouvement social et renonçant au principe de la solidarité organique et collective, certains syndicats se transforment peu à peu en de véritables agences de combines et de manoeuvres avec le pouvoir et le patronat au grand dam des travailleurs.
Laissés à leur triste sort et jetés en pâtures aux régies financières et institutions bancainres, véritables détentrices du pouvoir pécuniaire, ces derniers s’embourbent dans les eaux troubles de l’endettement et de la dépendance financière donnant ainsi raison à Orwell qui soutient que l’esclave moderne n’est pas enchaîné, mais endetté. Il ploie donc sous le poids lourd et écrasant d’un travail qui ne l’épanouit plus, mais l’ennuie, lui attire des vices et exacerbe davantage sa situation de misère sociale.
Ad vitam aeternam, il moisit dans son sinistre sort qui est de tirer le diable par la queue en attendant un autre premier mai…
Mansour Shamsdine Mbow
Professeur de Lettres et chroniqueur.