Dans notre société sénégalaise, il existe une croyance profondément ancrée : la réussite financière d’un individu est la preuve que ses parents ont été dignes, travailleurs, vertueux autrement dit “Sa Yaye, Sa Baye Moko Ligueye”.
Cette croyance, enracinée dans notre culture, célèbre les valeurs familiales, le mérite transmis, le sacrifice silencieux “Mougne”.
Mais aujourd’hui, face à la réalité brutale que vivent des millions de Sénégalais, cette phrase résonne comme une gifle. Une insulte, même.
Car si l’on pousse ce raisonnement jusqu’au bout, cela voudrait dire que ceux qui se noient dans la misère sont les enfants de « mauvais parents ». Ceux qui n’ont pas de toit décent seraient donc les fruits d’une lignée maudite ? Est-ce vraiment leur faute si un système corrompu leur barre la route, les prive d’espoir et les écrase ?
Quand la richesse devient un bouclier
Dans notre pays, lorsqu’une personne s’enrichit de manière fulgurante, elle entre dans une zone d’immunité. “D’où vient cet argent ?” devient une question interdite.
Celui qui ose la poser devient l’aigri, le jaloux, ou même le mal élevé. Pire : il est accusé de manquer de respect aux parents du riche. Comme si l’argent, aussi sale soit-il, blanchissait tout sur son passage : la vérité, l’éthique, la mémoire collective.
Et pourtant, nous savons que beaucoup de ces fortunes sont bâties sur le détournement, la corruption, la prédation. Cet argent volé aurait dû servir à construire nos hôpitaux, rénover nos écoles, former notre jeunesse…
Le respect aveugle comme poison
Ce culte de la richesse freine la société dans sa capacité à exiger des comptes aux puissants. Ailleurs, les citoyens se mobilisent, enquêtent, dénoncent les abus. Chez nous, on détourne le regard. Pourquoi ?
Parce qu’une part de cet argent volé est redistribuée sous forme d’aumônes, de dons ponctuels, de financements de lieux de culte, d’événements religieux… Une forme de dépendance s’installe. Et dans cette dépendance naît une loyauté toxique.
Le proverbe “Ne mords pas la main qui te nourrit” prend alors tout son sens. Mais quand cette main s’est enrichie en affamant des millions d’autres, devons-nous vraiment nous taire ? Quand cette main a pillé ce qui devait appartenir à tous, ne devons-nous pas, au contraire, lui arracher son masque ?
La société sénégalaise souffre aujourd’hui d’un respect mal placé. On respecte la fortune, pas l’effort. On respecte la puissance, pas la justice. On respecte le résultat, sans jamais questionner le chemin emprunté pour y parvenir.
Il est temps de redéfinir la réussite
La réussite ne devrait pas se mesurer uniquement en millions ou en milliards accumulés, mais en impact positif sur la société. Réussir, ce n’est pas bâtir un empire sur des ruines collectives. Un pays où les richesses sont mieux réparties est un pays où chacun peut espérer un avenir meilleur.
Nous devons briser ce mythe empoisonné de la réussite comme simple richesse. Nous devons oser dire que certaines fortunes ne sont pas bénies, mais maudites. Que certains « réussis » n’ont pas triomphé par mérite, mais par trahison. Et que cela n’a rien à voir avec leurs parents.
L’exemple des fonds Covid en est une illustration tragique : en pleine crise, certains ont trouvé le moyen de s’enrichir pendant que le peuple souffrait. Ce scandale est le miroir d’une société malade, où la morale s’efface devant les privilèges.
Il est temps de redéfinir ce que signifie « réussir » – non comme l’accumulation solitaire de biens, mais comme la construction collective d’une nation plus juste, plus humaine.
Reprendre le pouvoir de poser des questions
Tant que nous resterons figés par la peur de déranger, de déplaire, de remettre en cause des codes anciens, nous resterons esclaves d’un système qui nous écrase.
Il est temps de retrouver le courage de poser des questions. D’exiger des comptes. De refuser de nous taire. Il est temps de dire que la dignité du peuple vaut plus que l’image de quelques parvenus.
Aujourd’hui, nous devons cesser de glorifier l’argent pour l’argent. Cessons d’avoir peur de dire la vérité. Refusons de transmettre à nos enfants l’idée que le silence est plus sûr que la justice.
Ce combat est moral. Ce combat est culturel. Ce combat est citoyen. Il est notre devoir.
Un jour, nos enfants nous demanderont : “Pourquoi avez-vous laissé faire ?” et il faudra être capables de leur répondre avec dignité.
Mohamed NDIAYE
Coordination Pastef Normandie


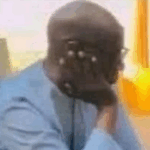







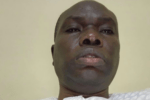

Merci a toi coordonnateur pour cette belle et pertinente réflexion
Diarama a toi mon coordinateur Vous avez touché la plaie Certaines pratiques ou supposées valeurs doivent être revues