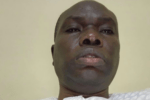Il me semble que le vent de contestation populaire qui a secoué le Sénégal ne soit pas un simple saut d’humeur, né du néant. Pour qui peut/veut voir, ce serait la conséquence d’une situation particulière, touchant la Nation. Le fruit des aspirations d’une partie du peuple. Si cette force qui cristallise à ce point une partie de la population est une herbe folle, autant parler d’un sol dont la contamination est bien avancée.
« Jeunesse malsaine » comme fit Abdou Diouf? Ou « terroristes » en puissance? Diagnostics assez viciés, pour ne pas dire vicieux. À ce propos, je n’arrive pas, avec la meilleure volonté, à comprendre comment un discours officiel étatique, autrement dit, ce qu’il y a de plus administratif, formel et concret, puisse se satisfaire d’une formule aussi creuse que « forces occultes »… Pour de la langue de bois, celle-ci est bien dure.
Au lieu de prendre un tel dédale, pourquoi ne pas se concentrer sur l’essentiel? Le pays.
Que ne puissions-nous tous travailler ensemble unir les forces plutôt que de se battre entre nous? Mais pour cheminer ensemble, faut-il (croire) avoir la même destination. Comme dit le Wolof, « ki ragal fanaan àll ak ki bëgul weet cibb neek, tëjal bunt bi du leen boole » (celui qui a peur de passer la nuit dehors et celui qui a la phobie de dormir seul, ne se disputent pas à savoir si la porte de la chambre doit être ouverte ou fermée).
Si, et puisque, la lutte entre des forces opposées est le moteur de ce monde, puissions-nous l’accepter, et savoir que sa vitalité est salutaire. L’estime pour l’adversaire, un devoir, car celui-ci est une glace dans laquelle se mirer, et se mesurer. Un tremplin pour se dépasser.
S’agit-il bien du pays, l’objet de la lutte? Pensons-nous que celui-ci soit indestructible, dans les faits autant que dans l’image?
Sommes-nous victimes de l’effet Pygmalion ou juste des lions-pygmées?
La France nous a érigés, pour l’Afrique, en exemple. Pourquoi nous est-il difficile de croire qu’il s’agisse là de la vieille tactique du « divide and rule ». Diviser pour mieux régner? On nous a tellement fait croire que nous sommes une exception en Afrique que nous avons pu finir par le croire. Et nous appelons ceux de la sous-région « niak » (les broussards), et eux nous taxent de wesh-wesh (qui tentent de ressembler aux Occidentaux).
Nous aurions pourtant pu tirer un effet positif de cette étiquette de figure de proue. En tout cas, nos congénères de la sous-région considérés, jadis, par les colons comme des individus de seconde zone, ont préféré se battre pour se donner meilleure image, et pas seulement aux yeux de l’ex-colon.
Si nous nous croyons différents des autres nations africaines, nous considérerons que la stigmatisation ethnique qui prend racine chez nous est différente de celle qui a enflammé le Rwanda.
Si tant est que nous nous voyons différents, nous croirons, mordicus, que notre récente focalisation sur les orientations religieuses d’autrui est différente de celle qui a crucifié le Nigéria.
Puisque nous sommes différents, les scènes d’individus « anonymes » qui violentent les manifestants ne peuvent en aucun cas équivaloir à celles des mercenaires qui firent basculer, dans l’horreur, le pays du vieux Houphouët.
Malé Fofana PhD
Auteur, Conseiller linguistique et communication
ComUnicLang-Bataaxel
Sherbrooke, Québec, Canada